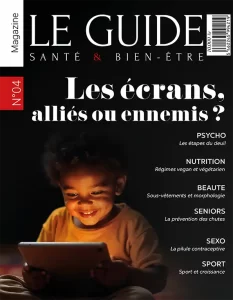À Madagascar, le taux de chômage est relativement bas, avec une estimation de moins de 5% en 2018. Cependant, malgré ce chiffre apparemment encourageant, la réalité de la précarité persiste parmi la majorité de la population malgache, se traduisant par un manque d’emplois stables et de revenus réguliers. En particulier auprès des jeunes.
Pourquoi tant de Malgaches vivent-ils dans des conditions précaires malgré un taux de chômage apparemment faible ? Les personnes que nous observons dans les rues vendant des citrons, proposant aux passants de faire des changes en euro ou dollars ou de réparer leurs téléphones peuvent-elles être considérées comme des chômeurs, et sinon, comment les percevoir? Selon la définition de l’Organisation internationale du travail (OIT), un individu est considéré comme chômeur s’il fait partie de la population active mais n’a pas d’emploi et recherche activement un travail. Dans cette perspective, l’État considère généralement comme chômeurs uniquement ceux qui sont officiellement enregistrés en tant que demandeurs d’emploi auprès de l’administration. Ainsi, ceux qui ont des occupations, même si elles ne sont pas stables, ne sont pas officiellement reconnus comme chômeurs par l’administration. Le ministère de l’Emploi, du travail, de la fonction publique et des lois sociales (MTFEPLS) estime à 65.963 le nombre total de demandeurs d’emplois entre 2019 et 2023. Le total des offres d’emploi reçu est estimé à 17.512 durant la même période. Par ailleurs, le taux d’occupation à Madagascar franchit la barre des 90%, tandis que le taux de précarité de l’emploi est de 80%, Madagascar représentant une population occupée, avec des emplois très pauvres, ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins.
Le Dr Aimé Herinjatovo Ramiarison, professeur d’économie à l’université d’Antananarivo estime que “dans un pays pauvre comme Madagascar, un taux de chômage faible démontre une situation socioéconomique difficile où les individus ne peuvent se permettre de rester au chômage faute d’un système de protection sociale efficace, quitte à occuper un emploi formel peu rémunérateur et sans aucune couverture sociale. Etant pauvres et vulnérables, les individus n’ont d’autre choix que d’accepter un travail même avec des conditions défavorables et précaires”.
Auprès des jeunes, cette situation est d’autant plus alarmante. Le MTFEPLS estime à 100.000 le nombre de jeunes demandeurs d’emplois chaque année, sur 34.000 offres d’emplois disponibles. Dans son étude “Création d’emplois à Madagascar, défis et recommandations”, le Dr Aimé Herinjatovo Ramiarison note que 83,8% des jeunes travailleurs occupent un emploi vulnérable comme celui d’aide familiale ou encore un emploi à son propre compte. Lorsqu’ils parviennent à obtenir un emploi rémunéré, près de la moitié d’entre eux exerce des emplois temporaires ou occasionnels. De plus, un pourcentage significatif (62,5%) occupe des postes pour lesquels ils ne possèdent pas les qualifications requises, et 75,4% se trouvent en situation de sous-emploi. En conséquence, leurs revenus mensuels sont modestes, souvent inférieurs à 40.000 ariary. Il est également important de souligner que la majorité des chômeurs et des nouveaux demandeurs d’emploi (soit 62%) appartiennent à la tranche d’âge des jeunes.
Cet économiste considère cependant comme étant une force la forte proportion de jeunes dans la population, soit 72,6% ont moins de 30 ans, avec une moyenne d’âge de 22 ans. Cette situation “confirme le dynamisme économique, qui ne serait que bénéfique pour le pays et pour la population”, souligne-t-il. Il suffit, selon lui, de leur donner l’opportunité d’accumuler des connaissances et des qualifications professionnelles dont ils ont besoin pour accéder au marché de l’emploi.
“La population malgache qui est majoritairement jeune démontre la forte potentialité économique du pays sur le marché du travail et sur le marché des biens et services. Ces jeunes constituent une réserve importante de force de travail et s’il leur est offert l’opportunité d’accumuler des connaissances et des qualifications professionnelles, à travers l’éducation et la formation, ils attireront des investissements productifs, source d’emplois productifs et décents, contribueront à la croissance de la productivité, stimuleront l’innovation et contribueront au renforcement de la compétitivité. Ils agiront donc positivement du côté de l’offre. Il ne deviendra réellement un avantage que si cette ressource humaine est formée selon les besoin des secteurs économiques à développer”, précise l’économiste.
Sauf qu’à Madagascar, le problème crucial de l’emploi et du chômage découle principalement des lacunes du système éducatif, avec des répercussions significatives sur l’insertion professionnelle des jeunes. Le secteur privé met particulièrement en avant l’inadéquation persistante entre la formation dispensée et les opportunités d’emploi, un défi non résolu depuis de nombreuses années. L’insuffisance de la qualité de l’éducation a des conséquences notables sur le marché du travail, comme le souligne le secteur privé. Thierry Rajaona, président du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM) s’exprimant sur la question de l’éducation à Madagascar lors d’une interview accordée au magazine Perspectives, explique que “le niveau général d’éducation des diplômés a considérablement diminué. Cette baisse de niveau a un impact négatif sur la compétence globale du personnel, incitant à une réflexion approfondie sur la nécessité d’améliorer la formation de base dès le primaire. L’objectif serait d’assurer que les diplômés soient immédiatement opérationnels sur le marché du travail, plutôt que de nécessiter une rééducation et une réforme post-diplôme”, explique-t-il.
Nambinina Jaozara