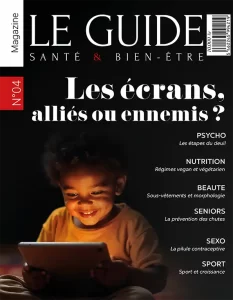Le phénomène d’exode rural trouve des explications dans les théories développées par les plus grands économistes. Celle émise par Ricardo se base sur le principe de la rente différentielle et la loi de rendement décroissant de la terre.
La théorie de la rente différentielle consiste à expliquer l’origine du prix des terres à payer au propriétaire foncier lorsqu’il les donne en exploitation à autrui. Or Ricardo a formulé la loi de rendement décroissant de la terre et affirme qu’en raison de l’augmentation de la population il est nécessaire de mettre en culture de nouvelles terres. Mais comme les parcelles les plus fertiles ont été cultivées les premières, chaque nouvelle terre a des rendements plus faibles que la terre précédente. Ainsi la rente différentielle va augmenter. L’accroissement du facteur travail suite à l’augmentation de la population fait qu’on cultive des terres de moins en moins fertiles. La fertilité des terres diminuant de temps en temps, la productivité agricole tend toujours à la baisse, ce qui amène à une réduction progressive de besoin en main d’œuvres.
La migration rurale et en particulier l’exode rural peut avoir des effets profonds sur le développement rural, la sécurité alimentaire, la nutrition et la pauvreté, car elle a une incidence sur la production agricole, les conditions de vie des ménages ruraux et l’économie rurale dans son ensemble. Les répercussions se font sentir à la fois dans les régions dont sont originaires les migrants et dans les zones de destination. Il importe de bien comprendre ce phénomène du point de vue du développement économique, en particulier parce que les incidences des migrations font souvent l’objet de débats très animés. Une perception négative de ce phénomène aboutit souvent à des politiques qui visent, de façon explicite ou implicite, à freiner ou à réduire la migration. Or ces politiques peuvent restreindre la main-d’œuvre dans le pays ou dans les secteurs d’activité qui en ont le plus besoin.
La ruralité, un espace à fuir ?
Pour avoir une définition du monde rural, il convient de faire une distinction entre rural et urbain. La distinction s’applique à l’espace et indirectement à la population selon la localité où elle réside. La définition de l’espace ou du milieu rural n’existe pas réellement. Le problème consiste à définir l’espace urbain et l’espace rural ou précisément la ville et la campagne. Ces deux espaces se différencient essentiellement par les rapports de l’habitat humain avec le milieu naturel. En milieu rural, il n’occupe qu’une petite partie de l’espace qui est dominé par les cultures et les écosystèmes naturels comme les forêts ou les pâturages. En milieu urbain, l’habitat humain est largement prépondérant et ne laisse qu’une faible partie de l’espace à la végétation. Il en résulte que le critère objectif le plus approprié au repérage des zones urbaines et rurales, est la densité de la population. En effet, il est difficile d’avoir une délimitation exacte du monde rural, mais le terme sous-entend “les populations qui résident à la campagne et les activités qui s’y déroulent”. A la différence de la ville, on constate un manque d’infrastructures dans la campagne. Le monde rural est surtout caractérisé par l’abondance des activités agricoles pratiquées par la population, un monde loin des pollutions, des bruits, des courses de la vie urbaine. Toutefois, on ne peut pas réduire le monde rural à l’agriculture et à l’absence d’infrastructures. En fait, la population rurale comprend des catégories socioprofessionnelles très variées. Elle inclut les agriculteurs et leur famille, les artisans ainsi que les représentants de certains services qui ont leur siège dans les villages et les bourgs et sans lesquels la vie à la campagne serait difficile : ce sont par exemple les commerçants, les employés de mairie, de la poste, les instituteurs, sans oublier les représentants de culte.
Les grandes agglomérations, destination des migrants
Le choix de province de destination des individus qui effectue une activité migratoire dépend de la raison qui les a poussés à migrer. Antananarivo est la province d’accueil la plus fréquente en recevant 32,9% des individus qui ont bougé depuis 5 ans. Il est suivi par Fianarantsoa avec 21,8%, puis Toamasina et Tuléar avec respectivement 15,8% et 11,8%, ensuite Mahajanga avec 11,2% et enfin Antsiranana avec 6,5%. Au niveau des différents milieux de destination, la capitale a accueilli 10,8% des migrants, ce qui est relativement important compte tenu de l’étendue des autres types de milieu. Ce phénomène est naturel dans la mesure où Tana reste le centre des activités économiques et sociales à Madagascar.
La commercialisation des produits agricoles, raison essentielle dans l’exode rural
Les paysans se plaignent à propos des difficultés dans la commercialisation des produits agricoles. Dans leur village, les acheteurs ne sont pas nombreux car les besoins alimentaires de chaque ménage sont assurés par leur propre production. Pour vendre leurs produits au marché, ils sont obligés de parcourir une longue distance (10km en moyenne). Chaque kilomètre supplémentaire de distance vers une route principale diminue le prix du riz à la production. Les villages situés loin des routes négocient des prix de paddy qui sont de 15 à 22% inférieurs à ceux ayant accès à la route. L’intégration du marché diminue avec l’isolement, selon ce qui est montré par le fait que l’autoconsommation, dans la consommation totale, s’élevait de 20% dans les parties les moins isolées à 40% dans les parties les plus isolées.
La force attractive de la ville
L’attraction exercée par les villes sur l’espace rural revêt une originalité indéniable. Les images médiatiques de l’abondance urbaine d’une part et l’illusion de trouver un emploi dans l’industrie moderne ou l’administration, d’autre part, expliquent ce phénomène. Le marché du travail urbain est un kaléidoscope de formes d’emploi les plus diverses. En mettant à part les cadres, les professions libérales et les capitalistes, on peut ainsi identifier au moins cinq grandes catégories d’emplois : salariés du secteur public ; salariés des grandes entreprises privées ; petits entrepreneurs familiaux de l’industrie, du commerce et de l’artisanat ; salariés de ces petits entreprises ; et enfin travailleurs “autonome” ou “auto employés”, c’est-à-dire qui pratiquent la vaste palette des activités de survie (domestique, vendeur ambulant, laveur et gardien de voitures …). Cinq segments entre lesquels il n’existe guère de frontières infranchissables. Ces emplois offrent aux ruraux des salaires un peu plus élevés que le revenu agricole moyen. Et c’est ainsi que l’excédent de main d’œuvre du milieu rural à très faible productivité est attiré par le secteur moderne de la ville. Pour les paysans sans terre, les miettes qui tombent de la table des riches sont plus abondantes en ville qu’à la campagne : la migration leur évite de mourir de faim. Mais ces paysans ont bien fait le calcul avant d’arriver à cette conclusion ?
RAKOTOARISOA Andriatahina