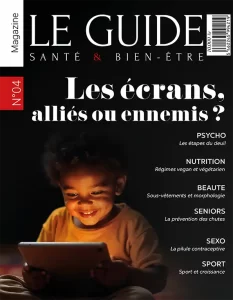Le 1er février, jour mémorable
Depuis des années, Purran tient un kiosque de fruits au Morne, l’un des sites historiques qui ont abrité la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes. Pour elle, « le 1er février est littéralement le jour de la liberté. Les gens viennent nombreux ici pour rendre hommage à leurs ancêtres, d’autres pour s’évader de la routine quotidienne, pique-niquer ou encore découvrir les monuments. Dans la journée, plus de 40 bus vont arriver. D’autant qu’il s’agit d’un jour férié ».
Comme à l’accoutumée, le monument international de la Route des Esclaves au Morne abrite la cérémonie officielle, suivie d’une performance artistique axée sur la transmission du patrimoine à la jeunesse.
« C’est un jour mémorable, dans la mesure où nous avons dit non à l’oppression et oui à la liberté. Comme nous le savons, Maurice est un pays multiculturel qui rassemble toutes les communautés, mais l’esclavage, c’est l’histoire de notre pays », a renchéri Véronique Leu-Govind, Junior minister des arts et de la culture.
Pour la professeure Myriam Cottias, présidente du comité scientifique du programme la Route de l’esclave de l’Unesco, l’Atlantique a été la trame de cette revendication au départ, mais l’abolition de l’esclavage est aujourd’hui commémorée à l’échelle nationale et internationale, pour ne citer que la Journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves, marqué le 25 mars et la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, le 23 août.
« Les routes des personnes mises en esclavage : résistance, liberté, héritage, est un programme lancé en août 1994 à Ouidah au Bénin, sur la proposition de Haïti, la lumière de la liberté pour les esclavisés du monde entier. Cette soif de liberté s’est répandue dans le monde. Mais pendant longtemps, c’est devenu une histoire de silence. La mission fondatrice de ce programme est justement de briser le silence sur cet événement tragique de l’histoire de l’humanité ».

Pour une justice réparatrice
“Resistance, liberté, Patrimoine dans l’Ouest de l’océan Indien”, c’est le thème principal de la Conférence internationale de l’Unesco sur les routes des peuples asservis, qui s’est déroulée du 3 au 5 février à l’Université de Maurice. Répondant à l’invitation du gouvernement mauricien et de l’Unesco, plus de 50 chercheurs issus des quatre coins de l’océan Indien ont participé au colloque.
« Cette conférence de haut niveau, en plus d’être une plateforme d’échange et de partage, constitue une occasion de réfléchir sur le lien entre l’impact de l’esclavage et nos défis actuels. L’idée étant également d’amener à une meilleure compression de ce phénomène, pour une justice réparatrice », souligne Dharambeer Gokhool, Président de la république de Maurice, en marge de la cérémonie d’ouverture
Parcours de Makua
Parmi les conférenciers, Jimmy Rakotonavory est revenu sur le parcours de Makua, une population bantoue d’Afrique orientale, à Mandritsara.
« Quand les Makua sont arrivés dans la partie septentrionale de l’île, les Merina ont déjà assiégé Mandritsara. C’est eux qui ont acheté les Makua comme esclaves. Après l’abolition de l’esclavage, les Makua ont épousé des Tsimihety, groupe ethnique de cette contée de l’île. Je suis moi-même un descendant de la 7e génération », a-t-il dit.
D’après les chercheurs, la réparation doit être au cœur de la justice, symbolique et historique.
« Il y a beaucoup à faire parce que nous avons connus 400 ans d’histoire de l’esclavage et nous sommes toujours en phase de résilience. Le fait est qu’il n’y a pas eu de deuil et forcément pas de remise en question », avoue Stéphan Karghoo, directeur du Centre Nelson Mandela pour la culture créole et africaine.
Pour une meilleure compréhension de l’esclavage, l’île Maurice dispose d’une série de sites historiques comme le Musée intercontinental de l’esclavage à Port-Louis, le Monument des esclaves à Pointe Canon à Mahébourg, le Bassin des esclaves à Pamplemousses et le Jardin de Pamplemousse dans le district du même nom situé Nord-Ouest de l’île Maurice. A cela s’ajoute également le Morne Brabant, une montagne de 555 m d’altitude dans le Sud-Ouest de l’île Maurice. Classé patrimoine mondial par l’Unesco en 2008 sous le nom de « Paysage culturel du Morne », le site était un sanctuaire pour les esclaves marrons un lieu de mémoire de la période coloniale de l’île.
Transmission de l’histoire à travers la culture
Le genre musical, Ségatikip, inscrit en 2014 sur liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, a résonné dans toute l’île tout au long de la commémoration de l’abolition de l’esclavage.
« Le Ségatipik constitue un héritage inestimable que nos ancêtres nous ont légué. Arrachés de leurs terres et privés de liberté, les esclaves ont exprimé leurs peines, leurs joies et leurs espoirs à travers la musique et la danse. C’est également un véritable langage pour communiquer entre eux et faire passer un message », a expliqué Tyron, artiste polyvalent.
Et au fil des années, les jeunes ont adopté une autre manière de commémorer cette date historique. C’est le cas du slameur, Max Juguilio Pierre Louis qui a décidé de rendre hommage à ses ancêtres en slam poésie. Son texte a d’ailleurs remporté le premier prix du « Konkour Slam Abolision Lesklavaz », organisé par le Centre Nelson Mandela dans la catégorie ado.
« Mon texte décortique la langue et la culture des Rodrigues. Nous sortons de beaucoup de pays d’Afrique, comme l’île de Gorée, Madagascar, Mozambique… A Rodrigues il y avait beaucoup d’esclaves marrons. Sur scène, j’incarne un esclave, qui arrive à se sauver des maîtres et veut emmener les autres avec lui tout en leur disant, venez, est-ce que vous voulez toujours subir les atrocités ou bien reprendre la liberté ! ».
Recueillis par Joachin Michaël