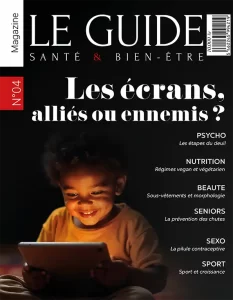Historiquement, le Kabary, art oratoire malgache émerge à l’orée du XVe siècle. Cela dit, Harilala Ranjatohery, historien, académicien et non moins mpikabary depuis plus de 45 ans, insiste sur la nécessité de repousser les limites de recherches sur cet art millénaire. Interview.
* Les Nouvelles : Pour commencer, parlez-nous de l’origine du Kabary ?
– Harilala Ranjatohery : Quand on parle de la genèse du Kabary malagasy, on fait allusion à Andriandranolava, un maître incontesté de l’art oratoire au 15e siècle. Il y a une part de vérité dans cet argument puisque la personne en question est réputée pour son excellente maîtrise de l’art de la prise de parole en public. Mais quand il s’agit du Kabary en tant qu’outil de négociation, de persuasion et de résolution de conflits sociaux, l’histoire remonte au 9e siècle, du temps du Rabefanontaniana. Reconnu à travers son intelligence et son ingéniosité remarquable, il est constamment sollicité pour négocier, convaincre et gérer les conflits sociaux. Faut-il rappeler que cette période était fortement marquée par le développement du commerce et de la relation internationale, aussi bien dans les hautes terres centrales que les zones côtières.
* La prise de parole en public a-t-elle toujours été une affaire d’hommes ?
– Je ne suis pas du même avis. Beaucoup de femmes se sont vues assignées cette noble tâche dans l’histoire de Madagascar pour ne citer que la souveraine Ranavalona I dans l’Imerina, la reine Ravahiny issue du pays Sakalava et Ramanantenasoa l’une des épouses d’Andrianampoinimerina à Alasora. Une tradition sacro-sainte du royaume Tanala de l’Ikongo, le kabarim-biavy est prononcé lors de cas d’abus d’autorité masculine envers sa conjointe ou ses enfants. Il s’agit d’une forme de justice de genre appliquée depuis le 19e siècle. De nos jours, le rôle de mpikabary est attribué aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Je pense que la société dans laquelle nous vivons ne pose plus de problème à cette ouverture de l’art discursif.
* Que pensez-vous de la reconnaissance du Kabary comme Patrimoine culturel immatériel de l’humanité ?
– Nous venons de célébrer le 15 janvier dernier la Journée nationale du Kabary et le 4e anniversaire de son inscription sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité. C’est une bonne chose dans la mesure où notre culture va susciter l’intérêt des citoyens du monde, qui vont certainement la découvrir et l’apprendre. D’un autre point de vue, nous avons également le devoir de préserver et de promouvoir notre patrimoine pour maintenir ce statut octroyé par l’Unesco, qui en effectue l’évaluation tous les trois ans.
Recueillis par Joachin Michaël