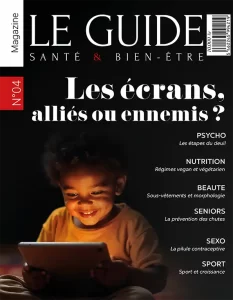Avec quelques jours d’avance, la célébration de la Journée internationale de la femme sera aujourd’hui au centre de notre attention. En effet, chaque année, le 8 mars, on sort les belles affiches, les discours inspirants, les bouquets de fleurs et souvent, on rappelle au monde que les femmes existent, qu’elles ont des droits et qu’il faut les respecter. C’est une bonne chose. Dans les différentes régions du pays, c’est même devenu un rituel de réunir les femmes et
les jeunes filles de la région à travers différentes cérémonies. Au grand dam de ceux qui se qualifient de féministes purs et durs, la journée devient presque une festivité et parfois on oublie l’essentiel. En tout cas, le plus important, et c’est déjà une avancée, c’est la reconnaissance envers les femmes durant cette journée.
Certains diront que, en toute logique, c’est loin d’être suffisant. Et pour cause, au-delà des sourires affichés sur les réseaux sociaux et des déclarations officielles, la réalité est tout autre. Beaucoup trop de femmes, ici à Madagascar, continuent de subir des violences physiques, psychologiques, économiques. Parmi ces violences, le viol conjugal reste encore un sujet tabou. Pourtant, il existe, et certaines victimes osent enfin en parler. Comme en témoigne récemment une femme battue par son propre mari pendant leurs rapports intimes au su de leurs voisins sans que ces derniers puissent intervenir. Eh oui, nous sommes en 2025, et ces horreurs se produisent encore.
Le plus désespérant ? Ce crime est puni par la loi. La lutte contre les violences basées sur le genre prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes salées. Mais encore faut-il que les victimes soient entendues, crues, soutenues. Trop souvent, elles préfèrent se taire pour éviter les histoires. Et pendant ce temps, les coupables dorment tranquilles.
Au-delà des violences, un autre constat s’impose : les femmes malgaches sont encore trop peu présentes dans les cercles de décision. À chaque élection, on promet des avancées. Et puis, les résultats tombent : peu d’élues à l’Assemblée nationale, pas encore suffisamment aux postes ministériels, quasiment absentes des mairies.
Pourtant, elles ont toute leur place dans les hautes sphères. Les décisions politiques influencent leur quotidien autant que celui des hommes : l’éducation de leurs enfants, leur sécurité, leur autonomie économique… Comment prétendre avancer vers l’égalité quand les premières concernées sont tenues à l’écart des discussions ?
Mais heureusement, tout n’est pas noir. Des associations et des initiatives locales tentent de changer la donne. Ces derniers temps, par exemple, des ONG accompagnent les survivantes de violences conjugales pour les aider à retrouver confiance en elles et à devenir autonomes.
Alors oui, le 8 mars est important. C’est une date pour rappeler que l’égalité est un droit, pas une faveur. Mais surtout, il ne faut pas que cette prise de conscience s’arrête à une journée. Offrir une rose, c’est gentil. Donner aux femmes les mêmes chances d’accéder à la liberté, à la sécurité, à l’autonomie, c’est mieux. Beaucoup mieux.
Rakoto