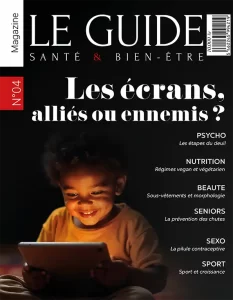Il y a des chiffres qui devraient alerter, voire réveiller les consciences les plus assoupies. Seulement 0,4% des écoles malgaches avaient accès à l’électricité en 2021. En 2025, selon un récent dossier du Fonds monétaire international (FMI), ce taux aurait à peine atteint les 2%. Une évolution dérisoire pour un pays qui prétend miser sur la jeunesse et le développement.
Mais l’électricité n’est que la partie émergée de l’iceberg. Car à Madagascar, l’école reste un luxe pour trop d’enfants. Le FMI, s’appuyant sur les chiffres de la Banque mondiale, indique qu’une école type n’a accès qu’à 34% des infrastructures essentielles à l’apprentissage. En clair : pas de toilettes, pas de mobilier, pas de matériel pédagogique, et encore moins de conditions favorables à l’épanouissement des élèves.
Seulement 4% des écoles disposent de suffisamment de manuels scolaires. Moins d’un quart a des outils technologiques, ou même du mobilier de base. Si 83% des établissements possèdent encore un tableau noir, c’est presque un symbole : celui d’une école figée dans le passé, à l’image d’un pays où l’accès à l’électricité dépasse à peine les 30% pour l’ensemble de la population.
Des initiatives qui misent sur la connectivité et l’électrification rurale existent, mais leur portée reste limitée face à l’ampleur des défis. Il ne s’agit plus uniquement d’implanter des panneaux solaires ou de distribuer quelques manuels, mais de refonder l’école, sur des bases solides. Et ce n’est pas tout, car il y a aussi le manque d’ infrastructures, des bancs, des matériels didactiques et sans oublier, les salaires des enseignants.
Ces défis ne sont donc pas seulement éducatifs. Ils sont aussi socioéconomiques et éminemment politiques. Une école sans lumière, sans livres et sans enseignants motivés est une fabrique de frustration et d’inégalité. Miser sur l’éducation, c’est investir dans l’avenir. C’est donner à chaque enfant, où qu’il vive, les clés de son émancipation. C’est élémentaire.
Rakoto