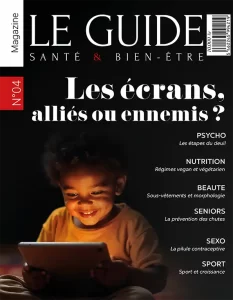Journée historique ce 1er février pour l’île Maurice, qui commémore le 190e anniversaire de l’abolition de l’esclavage. En amont de l’événement, le musée intercontinental de l’esclavage à Port-Louis, dans la capitale, propose un saut dans les temps à travers une installation thématique. Visite guidée en compagnie d’Armanda L. Bazile.
*Les Nouvelles: Pour commencer, parlez-nous du musée intercontinental de l’esclavage ?
-Armanda L. Bazile: L’édifice est un ancien hôpital militaire, construit durant la période française, à l’orée de 1740. Les murs sont des blocs de corail taillés à la main par les esclaves. C’est la preuve tangible que ces personnes ont été présentes dans l’île et qu’elles ont contribué à la construction de notre pays. Le musée a ouvert ses portes le 1er septembre 2023. Mais avant cela, de 2020 à 2023, nous avons organisé in situ des expositions temporaires.
*Comment la population mauricienne a accueilli cette initiative?
-Ce projet, un devoir de mémoire, est destiné à la population mauricienne. Dans ce contexte, nous avons établi une consultation auprès du public. Réconciliation, justice et vérité, ce sont en quelque sorte les mots qui sont sortis. Aujourd’hui encore, nous nous sentons le devoir d’éduquer la population sur cette histoire de l’esclavage.
*Le musée en quelques chiffres.
-En termes d’objets de collection, nous avons des artefacts qui parlaient de l’origine d’un cimetière oublié à Albion. Il s’agit des chapelets, des boucles d’oreilles, don de la Mozambique, mais également des ossements d’animaux taillés pour se défendre. Nous avons également des photos de familles, des portraits, des vidéos et des documents historiques. De septembre 2023 à décembre 2024, plus de 23.000 visiteurs sont passés dans notre établissement.
*Quel lien le musée entretient-il avec Madagascar?
– Dans la salle, nous présentons le témoignage de la famille Elisabeth, qui a décidé de faire des recherches sur leurs ancêtres avec la commission vérité et justice de 2009. Elles ont découvert qu’ Elisabeth était née à Madagascar avant d’arriver à Maurice en tant qu’Africaine Libérée. Elle a également rendu son dernier souffle ici. Quand on parle de Madagascar, on fait surtout référence à ceux qui sont venus en tant qu’ Africains libérés, ils ont été capturés et forcés à entrer dans ce système à leur insu.
*L’histoire retient aussi l’aventure et la mésaventure du prince Ratsitantanina?
– La forme de résistance la plus tenace est celle de marronnage. Les marrons sont ceux qui ont pris le risque et le courage de s’enfuir pour une quête de liberté. Pour tromper la vigilance de leurs maîtres, ils se sont cachés dans les grottes, les montagnes, les maisons des africains libérés. Parmi ceux-ci, nous avons Ratsitantanina. Il vivait à Maurice en tant qu’ esclave. Il s’est enfui, on l’a capturé, il a mené une rébellion. Il a été par la suite exécuté mais d’autres ont continué de marcher sur ses traces.
*Cet établissement public est-il aussi un musée des langues ?
– Les panneaux explicatifs sont écrits en langue créole mauricienne, en anglais, la langue administrative et en français. Nous sommes le premier musée de l’île à introduire le créole mauricien dans notre institution. L’idée étant de donner ses lettres de noblesse à cet héritage de nos ancêtres, qui a été pendant un moment mis de côté. Faut-il rappeler que la langue créole n’a pas été enseignée dans les établissements scolaires avant 2006. C’est après qu’il y a eu des formations des formateurs. Elle a été introduite dans nos écoles en 2012.
Recueillis par Joachin Michaël (Ile Maurice)