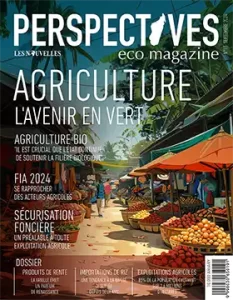Le constat est alarmant. Le lac de Mandroseza a connu une perte importante de volume d’eaux ces trois dernières décennies, comme c’est le cas dans plus de la moitié des lacs et réservoirs du monde, à cause du changement climatique et des activités humaines. Les problèmes d’approvisionnement en eau risquent de s’aggraver dans la Capitale.
Alors que le besoin en eau à Antananarivo augmente, la réserve d’eau du lac Mandroseza atteint son niveau le plus bas. Il perd environ 17 millions de litres par an. Une perte considérable de volume d’eau, due au changement climatique, mais surtout aux activités humaines qui produisent des rejets de pollution avec des déchets, de source auprès de la Jirama, hier, lors de la célébration de la Journée mondiale des zones humides (JMZH) sur les lieux.
Pourtant, avec une superficie de 43ha et une profondeur située entre 2,5 et 4,5 m, ce lac peut stocker jusqu’à 800 millions de litres d’eau. De plus, la qualité de l’eau se détériore à cause des activités anthropiques, en y jetant d’ordures et de la prolifération des constructions aux alentours ne respectant pas les périmètres de protection.
Si rien n’est fait, la crise d’approvisionnement en eau potable de la Commune urbaine d’Antananarivo et ses environs va s’aggraver davantage. Une des raisons pour laquelle le lac Mandroseza a été choisi pour abriter la célébration de la JMHZ.
Selon toujours notre source, on observe actuellement un gap de 85 millions de litres par jour. Même si la centrale de traitement d’eau de Mandroseza parvient théoriquement à purifier 215 millions de litres d’eau par jour, ce volume ne suffit pas à couvrir le besoin de la capitale et ses environs, s’élevant à 300 millions de litres par jour. Or, cette centrale assure les 90% des approvisionnements dans la région.
Célébration de la JMZH
La JMZH a pour thème « Protéger les zones humides pour notre avenir commun ». L’objectif est de renforcer la sensibilisation et la prise de conscience de l’importance des zones humides et leur rôle crucial, tout en promouvant leur gestion durable.
« Les zones humides fournissent l’eau qui est un véritable système sanguin de la biosphère, contribuant au maintien des écosystèmes et des populations humaines », a indiqué le ministre de l’Environnement et du développement durable (Medd), Max Andonirina Fontaine.
« Nous saluons ici l’intérêt porté par le ministère de l’Environnement à vouloir célébrer cette journée mondiale des zones humides ainsi qu’à leur protection », a fait remarquer de son côté le ministre de l’Eau, de l’assainissement et de l’hygiène, Lalaina Andrianamelasoa.
Sur les 2.414 sites de zones humides de la planète inscrites dans la liste Ramsar, 21 (0,89%) se trouvent à Madagascar, occupant une surface de 2.147.911 hectares, de source auprès du Medd.
Parmi les sites les plus renommés, le Parc national Tsimanampetsotse, le premier site Ramsar à Madagascar, la Barrière de corail de Nosy Ve Androka, le Complexe des lacs Ambondro et Sirave dans la Commune rurale de Belo-sur-Mer, les zones humides de Sahamalaza ainsi que le parc de Tsarasaotra ou parc d’Alarobia, le seul site Ramsar privé de la Grande île. La baie d’Ambaro (Diana) est le 21e et dernier site classé en 2020.
Les types de zones humides à Madagascar sont constitués de lacs, de rivières, de marais et de marécages d’eau douce ainsi que de mangroves. Ces dernières ont comme principaux de réduire les inondations et d’atténuer les sécheresses. Elles protègent également les côtes des conditions météorologiques extrêmes comme les cyclones et absorbent naturellement le carbone dont les méfaits ne sont plus à démonter.
Sera R. et L.R.