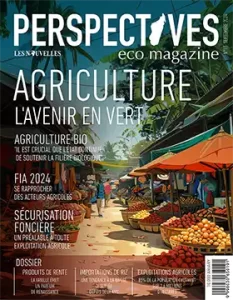Comme chaque année, le 7 avril, le monde entier s’est recueilli à l’occasion de la Journée internationale de réflexion sur le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Trente et un ans après, le souvenir de cette tragédie résonne encore, comme une blessure ouverte dans la mémoire collective de l’humanité, notamment sur le continent africain. Plus d’un million de vies ont été arrachées en l’espace de cent jours. Au-delà du devoir de mémoire, cette journée appelle à une réflexion profonde pour chaque nation, y compris Madagascar. Car il s’agit d’une leçon universelle sur les ravages de la haine, de l’indifférence, et du silence complice.
Madagascar, tout comme d’autres pays, n’est pas à l’abri des tensions identitaires, de la montée des discours haineux ou de la stigmatisation de certaines catégories sociales, principalement lorsque la tension politique monte. Il est en effet malheureux de constater que des discours frôlent la haine lorsque le camp d’en face n’est pas du même avis que l’autre durant certains débats politiques, que ce soit à la radio ou à travers les réseaux sociaux. Apparemment, certains oublient souvent mais l’histoire nous enseigne que les génocides ne commencent pas forcément dans le vacarme des armes, mais également dans le murmure de l’intolérance et des divisions entretenues. A ce titre, il revient à chacun, en tant que société, de cultiver l’éducation à la paix, le respect de l’autre et la cohésion nationale.
Le Rwanda d’aujourd’hui est devenu un modèle de résilience, de réconciliation et de développement et cette capacité à se relever force le respect. Mais il ne faut pas passer par cette étape pour comprendre le véritable sens du vivre ensemble. L’appel lancé par les Nations unies à Madagascar avec les représentants étatiques lors de la journée d’hier est clair : il faut combattre toutes les formes de haine, de discrimination et d’exclusion.
Rakoto