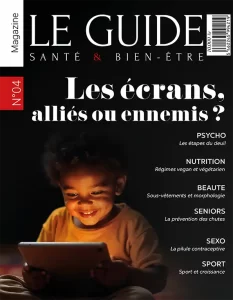Alarmant, la paupérisation persiste et stagne à Madagascar, d’après une étude menée conjointement par la Banque Mondiale et l’Instat. La présentation de cette évaluation de la situation de pauvreté à Madagascar a été effectuée le 22 février dernier. La collecte des données de cette évaluation a débuté dès 2020, interrompue par la crise sanitaire, puis repris en 2021.
Les chiffres clés
Au niveau national, le niveau de pauvreté est à 75,2%. Les auteurs de cette évaluation constatent “une légère augmentation comparée à 2012 où ce taux était de 72,9%”. L’une des causes de cette pauvreté qui s’aggrave est le manque de croissance du pays et d’investissement. “C’est à travers l’investissement privé que les emplois sont créés, il n’y en a pas eu assez (…). Ce manque d’investissements a été provoqué par un dysfonctionnement du marché, résultant de lacunes en termes d’infrastructures et d’une faible concurrence. Les zones urbaines, génératrices d’emplois et de croissance économique, ont connu un recul à cause de ce déficit en investissement”, explique Francis Mulangu, économiste principal à la Banque mondiale.
Pour comparer, la consommation médiane de l’Afrique Subsaharienne en 2022 est 8,7 fois supérieure à celle de Madagascar. L’étude souligne également que les 13% les plus riches à Madagascar consomment comme la classe moyenne en Afrique subsaharienne, et les 5% les plus riches à Madagascar ont une consommation du niveau de celle des 60% plus riches de l’Afrique subsaharienne. En d’autres termes, “On peut être riche à Madagascar, mais quand on compare cela à l’Afrique subsaharienne, on se situe un peu finalement dans la classe moyenne”, poursuit l’économiste.
La pauvreté rurale est à 79,9%, quasiment le même taux observé en 2012 qui était de 80,6%. La pauvreté urbaine a sensiblement augmenté, passant de 42,2% en 2012 à 55,5% en 2022, et à 61% dans les villes secondaires. L’écart du bien-être entre le milieu urbain et rural s’est réduit car les conditions de vie en milieu urbain se sont détériorées, selon les explications de l’économiste principal de la Banque mondiale. Bref, les inégalités se sont réduites à Madagascar, mais pas forcément dans le bon sens. “Quand le niveau de vie des personnes vivant en milieu urbain se baisse, ils convergent vers le milieu rural ou vers la pauvreté rural”.
Seuil de pauvreté à Madagascar
La ligne de pauvreté à Madagascar est établie à 4.048 ariary par personne par jour. “Une première partie, 2.756 ariary par jour et par personne, constitue coût quotidien d’un panier permettant à un Malagasy de consommer 2.133 kilocalories, tandis que le coût quotidien pour un niveau de vie de base est fixé à 1.291 ariary”, fait savoir cette évaluation.
D’après cette étude, le taux de pauvreté le plus élevé dans le pays est enregistré dans le sud et sud-est, mais le plus grand nombre de pauvres vit dans le Sud profond et le Centre. “Cela est dû à la vulnérabilité aux aléas, notamment le kere et les chocs cycloniques survenant dans le sud-est de l’île”, avance Francis Mulangu.
Les causes
D’après les données du RGPH de 2018, les gains en capital humain sont modestes. L’achèvement du niveau primaire est très bas, de l’ordre de 47%. Et même parmi ce taux, on constate un problème de qualité. Un tiers des enfants entre 5 et 11 ans travaille, de même que plus de 60% des enfants entre 12 et 14 ans.
Les enfants qui arrivent en fin de CM2 ont une compétence de lecture d’environ 6/10 et 2/10 en mathématiques. En outre, 95% des enfants de 10 ans sont considérés comme “pauvres en apprentissage”, ce qui veut dire qu’ils n’arrivent pas à comprendre un texte simple. Plus de 80% des enfants manquent l’école chaque année à cause de l’absentéisme des enseignants et des désastres climatiques.
Madagascar a également un problème par rapport aux mariages et grossesses précoces des adolescents. “Quand une femme de 15 à 19 ans tombe enceinte, cela réduit l’opportunité d’investissement en capital humain et les opportunités de travail”, alerte Ana Maria Oviedo, économiste senior sur la pauvreté à la Banque mondiale. Sur le marché du travail, la plupart des gens ont un emploi précaire et dépendent davantage de l’emploi familial. Le secteur formel et le travail rémunéré reste extrêmement bas.
Les auteurs de cette évaluation tablent sur “un nouvel équilibre qui favorise une croissance large et soutenue”. Cela passe par une concurrence accrue du secteur privé et un climat favorable aux affaires, une amélioration de la connectivité, de la fourniture d’énergie, et de l’accès aux services numériques.
Tiana Ramanoelina