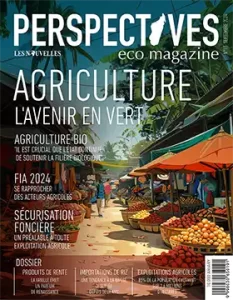Dans le sillage de la commémoration de l’événement du 29 mars 1947, la « mention Histoire » de la faculté des Lettres et Sciences humaines de l’Université d’Antananarivo a organisée une journée d’études consacrée aux violences coloniales à Madagascar, vendredi dernier.
Cette rencontre, ayant rassemblé un parterre d’historiens pour analyser l’impact durable de la colonisation sur la société malgache, a permis de dresser un premier état des lieux des multiples formes de répressions et d’exactions commises sous l’occupation française.
Dès les premières interventions, le constat a été unanime : la colonisation ne s’est pas limitée à une domination politique et économique, elle a aussi été marquée par des violences physiques, psychologiques et culturelles. La conquête territoriale, souvent qualifiée de pacification, s’est traduite par des affrontements sanglants, causant des dizaines de milliers de morts. Des biens ont été spoliés, qu’il s’agisse de terres agricoles ou d’habitations. Les interventions de Raivolala Rahelison et Felondzohary Razanakolona ont mis en lumière ces injustices, démontrant comment la dépossession a fragilisé durablement l’économie locale.
Déficit de mémoire
L’impact psychologique et social de la colonisation a également été abordé. Sur ce point, Helihanta Rajaonarison a exposé la manière dont la population locale a été reléguée au rang de simple main-d’œuvre au service des colons, générant un profond traumatisme collectif. De leur côté, Roland Rakotovao et Jeannot Rasoloarison ont illustré les répressions militaires et policières qui se sont poursuivies bien après la conquête, comme c’est le cas des exactions des tirailleurs sénégalais.
En tout cas, si certains épisodes sont relativement connus, comme les révoltes de 1947, d’autres pans entiers de l’histoire coloniale restent méconnus du grand public. La guerre de conquête, les mesures répressives contre les militants indépendantistes ou encore l’indigénat et ses abus sont rarement évoqués dans l’espace public.
Ce déficit de mémoire contraste avec les démarches entreprises par d’autres pays africains. Des commissions « Vérité et Réconciliation » ont vu le jour ailleurs, impliquant parfois les anciennes puissances coloniales. Madagascar, quant à lui, semble en retard sur cette question, comme l’ont souligné plusieurs intervenants. La restitution du kabeso de Toera en 2018 marque un premier pas, mais reste insuffisante pour enclencher une véritable réflexion historique.
Rakoto